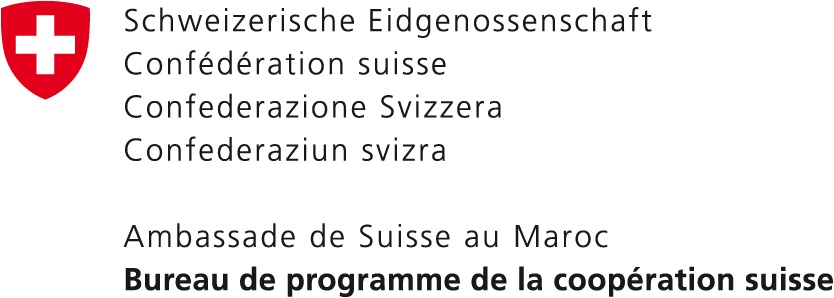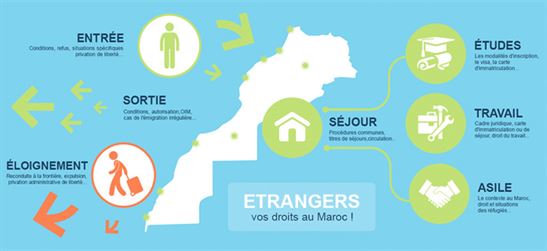Appelez nous : +212 (0)537-770-332

02.03.2020 | «La réussite sociale contractée à l’étranger influence les projets migratoires»
Dans une étude sur l’immigration féminine marocaine, l’enseignant-chercheur Mohamed Khachani explique que la réussite sociale affichées par certains Marocains résidant à l’étranger influence les projets migratoires, y compris chez les mineurs, pour qui l’immigration est synonyme d’un enrichissement d’abord financier.
Mohamed Khachani est enseignant-chercheur à l’université Mohammed V Agdal. Il est également le coordinateur du Groupe de recherches et d’études sur les migrations (GREM) et secrétaire général de l’Association marocaine d’études et de recherches sur les migrations (AMERM). Son étude s’intitule «La femme marocaine en migration : du regroupement familial à l’émigration autonome et individuelle» (2018).
Comment l’immigration économique a permis à la femme de faire évoluer son statut social ?
L’immigration marocaine se décompose en plusieurs phases, notamment celle des années 60-70, durant laquelle les migrants étaient principalement masculins. Les femmes, elles, étaient très peu nombreuses à immigrer de façon autonome : la plupart du temps, elles rejoignaient leur mari. Puis, à partir de la moitié des années 80, les femmes ont commencé à migrer dans les mêmes conditions que les hommes, c’est-à-dire de façon autonome, individuelle, pour les mêmes raisons que les hommes : améliorer leurs conditions de vie en trouvant un emploi mieux rémunérateur, dessinant ainsi un nouveau profil de femmes migrantes.
La différence avec l’immigration masculine, c’est qu’il y a une diversification plus prononcée des pays de destination : leurs destinations privilégiées ont été l’Espagne et l’Italie, ainsi que les pays du Golfe et, dans une moindre mesure, la Libye.
Dans quel cadre se fait le départ de ces femmes dans les pays du Golfe et à quelles difficultés sont-elles confrontées une fois sur place ?
Leurs conditions de vie sont évidemment bien meilleures dans les pays européens que dans les pays du Golfe, qui se caractérisent par un système culturel et juridique qui ne s’inscrit pas dans l’universalité des droits de l’homme. Pour une partie des femmes qui migrent dans ces pays – je dis bien une partie, car beaucoup des Marocaines qui migrent sont aussi des cadres, des ingénieures, des représentantes de firmes internationales, des cheffes d’entreprises qui correspondent à un profil complètement différent de celles qui sont parties dans les années 80-90 – beaucoup sont victimes de réseaux de traite humaine ou confinées à des travaux domestiques.
De plus, dans les pays du Golfe, le système de kafil s’inspire des traditions locales de protection et d’accueil des femmes, mais a vite dérapé vers un statut de pré-esclavage. Des femmes se sont ainsi retrouvées victimes d’abus, d’agressions sexuelles, d’agression tout court… Au consulat marocain de Jeddah, certaines sont arrivées avec des histoires terribles.
Les ambassades et les consulats commencent à s’occuper de ces femmes mais il y a toujours des drames qui se trament. Certaines partent avec des contrats de travail mais, une fois sur place, se retrouvent dans une situation qui n’a rien à voir avec les clauses du contrat. Même en Syrie, à Damas, avant la guerre, j’ai eu l’occasion de rencontrer des jeunes femmes marocaines qui se prostituaient dans des boîtes de nuit, alors qu’elles étaient venues pour occuper d’autres emplois.
Le point commun de toutes ces femmes qui migrent, aussi bien en Europe que dans les pays du Golfe, n’est-il pas que toutes se retrouvent dans des situations précaires une fois arrivées dans le pays d’accueil, obligées d’accepter des postes peu rémunérateurs et pénibles ?
Il y a celles qui travaillent dans des familles et qui sont logées au sein de ces familles. Pour ces femmes, leur salaire, c’est de l’épargne. Et il y a les autres, notamment en Italie, en France, en Espagne, où elles travaillent effectivement dans des conditions précaires, avec des salaires qui atteignent parfois à peine le smig. Mais il y a aussi des success-story, avec des Marocaines qui excellent dans les pays où elles immigrent, dans le domaine politique, social, culturel… En France, vous avez Najat Vallaud-Belkacem, Leila Slimani ; aux Pays-Bas, Khadija Arib, présidente de la chambre basse du Parlement. Les exemples de success-story sont nombreux.
Vous dites que le projet d’émigrer est souvent enclenché sous l’effet d’autres facteurs d’attraction que ceux économiques, notamment l’image de réussite sociale des immigré(e)s de retour au pays pendant leurs vacances annuelles…
Oui, effectivement, l’image de la réussite sociale contractée à l’étranger influence les projets migratoires, y compris chez les mineurs. Lors d’une enquête sur l’emploi des mineurs dans la région du Nord, j’ai rencontré une petite fille de huit, neuf ans qui, en réponse à une question que je lui posais sur ses aspirations, m’a répondu, parmi cinq possibilités de réponse, dont aller à l’école, se marier, apprendre un métier, qu’elle voulait immigrer ! Elle voulait aller en Espagne. Comment une fillette de cet âge peut incuber un projet aussi lourd de conséquences ? Eh bien, elle connaissait une femme qui était partie vivre en Espagne et avait fait construire une grande maison au Maroc. Les signes d’enrichissement qu’elle étalait quand elle revenait au Maroc l’été, c’était ce à quoi aspirait cette petite fille, pour qui la seule possibilité de réussir socialement était de partir sous d’autres cieux.